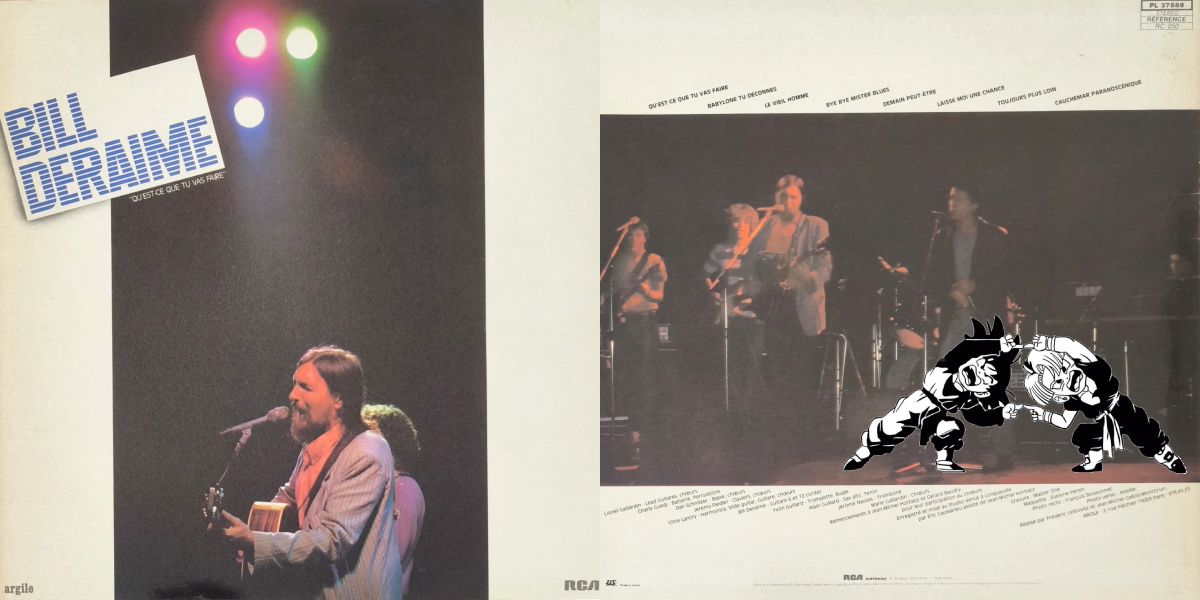Quand on parle de classiques du rock américain, il y a les albums qui racontent une époque, et puis il y a Their Greatest Hits 1971-1975, un best-of qui finit par définir toute une génération. Sorti en 1976, ce vinyle est rapidement devenu plus qu’un simple condensé de tubes : il s’est transformé en bande-son quasi obligatoire des après-midi d’été, des road trips au volant d’une décapotable imaginaire, et des soirées entre amis où Take It Easy tourne en fond sonore.
Quand les années 70 prennent leur envol
À l’origine, Their Greatest Hits n’était pas un nouveau concept audacieux ou une déclaration artistique révolutionnaire : c’était plutôt une capsule temporelle soigneusement assemblée des meilleurs morceaux des quatre premiers albums du groupe — Eagles (1972), Desperado (1973), On the Border (1974) et One of These Nights (1975).
La compilation arrive à un moment charnière : après plusieurs albums salués par la critique et une popularité croissante, elle sert de résumé accessible de l’identité musicale du quintette. À sa sortie en février 1976, l’accueil est très favorable et le public se l’arrache, plaçant l’album plusieurs semaines en tête des charts américains.
Ce vinyle devient même le premier à être certifié disque de platine par la RIAA, marquant une étape importante de l’industrie musicale. Depuis, il accumule certifications et records de ventes — au point d’être aujourd’hui certifié quadruple diamant pour plus de 40 000 000 d’exemplaires vendus rien qu’aux États-Unis, une performance historique.
Soleil couchant, guitares chaudes et harmonies célestes
D’emblée, ce qui frappe sur Their Greatest Hits, c’est cette capacité à envoyer du country rock doux, sans jamais tomber dans l’écueil du morceau daté ou kitsch. Entre harmonies gracieuses et guitares acoustiques enveloppantes, l’album est l’un de ces rares exemples où une compilation peut s’écouter comme un vrai long-jeu cohérent, presque comme un album inédit à part entière.
Les chansons — de Take It Easy à Witchy Woman, de Tequila Sunrise à Peaceful Easy Feeling — balancent avec élégance entre folk, rock, country et pop : un cocktail « smooth » qui a contribué à forger l’archétype du son californien des années 70.
Techniquement, on y trouve des arrangements aériens, des harmonies vocales impeccables, et une instrumentation qui fait la part belle aux guitares acoustiques et électriques, tout en laissant respirer chaque morceau. On ressent à la fois la maîtrise de la mélodie et cette emphase subtile qui pousse à fredonner les refrains encore longtemps après que le disque ait fini de tourner. C’est un peu comme si l’album vous tape sur l’épaule et vous dit : « Relax, tout va bien » .
L’émotion est là aussi, notamment sur des titres plus introspectifs comme Desperado, où la voix de Don Henley, fragile mais sincère, transforme une ballade en moment presque méditatif.
Plus qu’un best-of : une époque gravée dans le vinyle
Alors, Their Greatest Hits 1971-1975 est-il le meilleur album de tous les temps ? Peut-être que certains puristes hausseront un sourcil (voire deux). Mais il est incontestable que cette compilation a capturé l’esprit d’une époque, transcendé les modes, et continué de séduire générations après générations — suffisamment pour entrer dans l’histoire (et dans nos platines) avec une longévité remarquable.
Pour un amateur de vinyles jusqu’à 1985 comme toi, c’est un indispensable, un incontournable de toute collection digne de ce nom. Et si certains critiquent parfois son côté « grand public », c’est justement ce charme accessible — mais pas simpliste — qui en a fait un plaisir universel.
Bref, avec ce disque sous le bras, tu es à peu près sûr d’avoir la Peaceful Easy Feeling garantie à chaque écoute.